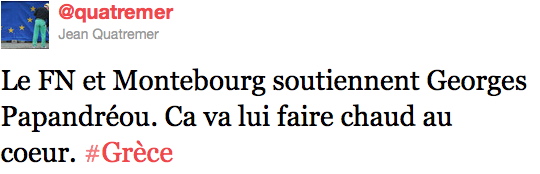Je lis dans la reprise française d’un article du Los Angeles Review of Books consacré au mouvement Occupy Wall street ce jugement à propos de l’influence des médias en ligne: «la plupart de nos discours sur internet prêchent des convaincus» (Mike Davis, « À court de chewing gum« , traduit de l’anglais par Samira Ouardi, Mouvements, 29/10/2011).
Cette idée correspond assez bien à ma propre perception du web comme un univers de bulles relativement étanches, dont l’intercommunication est limitée par la pléthore informationnelle, ainsi qu’à mon expérience de la grève des enseignants-chercheurs de 2009, très peu reprise par les grands médias, alors même que le mouvement disposait de divers relais en ligne.
On peut déduire de cette analyse que le pouvoir des médias dominants reste celui de faire circuler une idée ou une représentation au-delà de ses frontières « naturelles ». Mais à peine a-t-on émis cette suggestion que la question se pose: à quoi tiendrait ce pouvoir des organes traditionnels, puisque leur fonctionnement n’est pas fondamentalement différent de la construction d’une communauté en ligne, qu’ils s’adressent bien à un lectorat ciblé, et que les limites de l’édition physique augmentent encore l’état des contraintes?
Pour expliquer cette particularité, il faudrait dégager les mécanismes qui permettent à l’information de circuler entre les rédactions, comme les effets de connivence professionnelle, la production centralisée de l’information par l’intermédiaire des agences, les revues de presse ou les pratiques de consultation de la concurrence. Les médias ont pour caractéristique d’être leur meilleur public, et de comporter des systèmes de veille qui favorisent la reprise de l’information, marchandise précieuse. Dans cette approche, la perméabilité des grands médias ne résulterait pas d’une différence de nature avec le web, mais de la structuration particulière de l’univers professionnel et de mécanismes de mutualisation bien rodés.